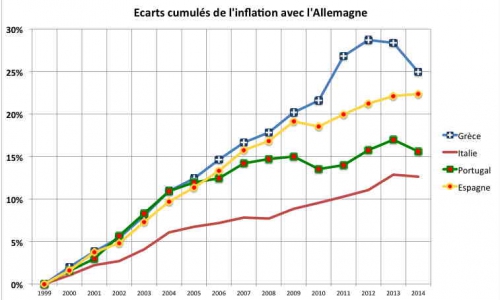Ukraine : la guerre des oligarques
Par Jacques Sapir (Site Russeurope)
Les événements des ces derniers jours à Kiev montrent les tendances à la désintégration du système politique. Mais, ces mêmes tendances sont, peut-être porteuses d’espoir en ce qui concerne le conflit que ce pays connaît depuis février 2014.
La guerre des oligarques
Le pouvoir à Kiev reste largement sous l’influence des oligarques. Le désordre institutionnel issu des événements de février 2014 a même plutôt renforcé leur influence. Ces derniers, unis dans leur opposition à l’ancien Président, M. Yanoukovitch, se sont répartis le pays et se déchirent à belles dents depuis un an. Il faut ainsi citer Rinat Ahkhmetov, dont la fortune était concentrée dans la sidérurgie, l’actuel Président, Poroshenko, dont la fortune venait de l’agro-alimentaire, Dmitro Firtash (actuellement en état d’arrestation à Vienne sur une affaire de corruption) et M. Igor Kolomoisky[1]. C’est Dmitro Firtash qui, depuis son domicile à Vienne, et alors qu’il était assigné à résidence, a réuni ces oligarques et les a convaincus d’agir contre M. Yanoukovitch, lui-même un autre oligarque, mais le Président régulièrement élu du pays.
Ce « complot des oligarques » a joué un rôle important, à la fois parce qu’il a permis de faire dévier le mouvement de Maïdan qui, au départ, était anti-oligarchique et anti-corruption, mais aussi parce qu’il a joué un rôle important dans la séquence des événements qui ont poussé le Président Yanoukovitch à fuir Kiev. Pour autant, cette alliance n’a nullement mis fin aux oppositions féroces qui traversent les milieux oligarchiques. En un sens, ces dernières ont été aiguisées par la brutale contraction que l’économie connaît. Dans un pays où le PIB s’est contracté de -7% en 2014, en proie à une inflation brutale et où les paiements sont au mieux incertains, seul le contrôle sur des rentes, ou des revenus fournis par l’étranger (l’aide économique), est en mesure de satisfaire leurs appétits. Cela renforce les antagonismes anciens, un instant masqués par une commune opposition à Yanoukovitch.
Cette opposition a pris un tour particulièrement spectaculaire avec l’éviction de M. Igor Kolomoisky mardi 24 mars au soir du poste de gouverneur de la région de Dnepropetrovsk. Mais l’enjeu de ce conflit va bien au-delà d’une simple révocation. Ce qui s’est joué entre le 22 et le 24 mars, avec la montée de la tension déjà perceptible depuis plusieurs semaines entre M. Poroshenko et M. Kolomoisky n’est pas seulement un nouvel épisode de la classique « guerre des oligarques »[2]. La personnalité de M. Kolomoisky dépasse en effet le seul domaine économique. Les positions politiques qu’il a prises depuis un an en font en effet un homme clef du pouvoir à Kiev.
Qui est Igor Kolomoisky ?
Kolomoisky était jusqu’à cette date le gouverneur de la région de Dnepropetrovsk et, à tous les égards, un des grands barons de cette Ukraine semi-féodale qui a émergé depuis les événements de la place Maïdan. Igor Kolomoisky est un homme très riche. Il a un passeport chypriote (et un passeport israélien), est résident suisse, tout cela sans avoir renoncé à sa nationalité ukrainienne. Il détient notamment PrivatBank, la première banque d’Ukraine, et la chaîne de télévision 1+1. Il possède aussi 43% des parts de la compagnie nationale de pétrole et de gaz UkrNafta et de sa filiale UkrTransNafta, qui gère plusieurs oléoducs. Dans les faits, il contrôle une large part de la circulation des carburants en Ukraine. Sa position stratégique s’est affirmée depuis le début de la crise. Il a consacré une partie de sa fortune, évaluée entre deux et trois milliards de dollars, à la mise sur pied de bataillons de volontaires. Aujourd’hui, ce sont 10 bataillons de la Garde Nationale qui sont directement financés par Igor Kolomoisky. Ces bataillons sont largement présents dans le sud de l’Ukraine, autour de Mariupol. Cette initiative s’est révélée cruciale alors que l’armée gouvernementale ne pouvait faire face seule aux séparatistes dans l’Est du pays. Le mécène a donc endossé un rôle politique en devenant gouverneur de Dnipropetrovsk, une province stratégique car voisine de celle de Donetsk. En l’espace de quelques mois, il s’est ainsi imposé comme un « rempart » contre la rébellion des provinces de l’Est de l’Ukraine, et il a passé pour ce faire des alliances étrange avec le groupe fascisant « Secteur Droit ».
Ces bataillons de la Garde Nationale constituent cependant une « armée privée », dont même la logistique ainsi que l’armement échappent au contrôle réel de l’armée régulière. On peut comprendre que le Président nouvellement élu, M. Poroshenko, en ait pris ombrage et ait cherché à réduire le pouvoir de M. Kolomoiski. C’est dans ce cadre qu’il faut comprendre les événements qui se sont produits ces derniers jours. Ils s’apparentent au scénario du roi cherchant à réduire le pouvoir d’un grand féodal. L’histoire de France est remplie de l’écho de ces conflits. Mais, ils se sont achevés il y a maintenant près de trois siècles. Le fait qu’ils se produisent aujourd’hui en Ukraine est un indicateur indiscutable du fait que ce pays n’est pas encore un État au sens moderne du terme.
L’affaire Kolomoisky
Le Président Poroshenko a donc décidé de limiter le pouvoir économique de son rival. Il a décidé de remplacer la direction de Ukrainafta. La réaction de Kolomoisky a été rapide et brutale. Le bâtiment de UkraiNafta a été occupé par des hommes armés, à l’évidence des hommes du bataillon Dnipro-1, financés et armés par Kolomoisky. La réaction de Poroshenko a été rapide, et il a démis Kolomoisky de ses fonctions de gouverneur de Dnepropetrovsk. Il a aussi fait arrêter, à l’issue du Conseil des Ministres, Sergey Bochkovsky et Vasily Stoyetsky, respectivement directeur et vice-directeur de l’agence des situations d’urgence. Ces deux hommes sont accusés de malversations financières diverses. Mais Igor Kolomoisky a répliqué en appelant à reconnaître les responsables des entités insurgées de Donetsk et de Lougansk, la DNR et la LNR. Les députés et responsables de Dnepropetrovsk ont alors commencés à évoquer les promesses de décentralisation non tenues par Kiev. On sait que le pouvoir de Kiev se refuse, pour l’instant, à toute idée de décentralisation et de fédéralisation. De fait, ces députés et ces responsables, dont nul ne peut ignorer la proximité avec Igor Kolomoisky, ont tenu des propos qui font écho aux déclarations des dirigeants de Lougansk et de Donetsk. A son tour, le dirigeant de la DNR Alexandre Zakhartchenko a suggéré au gouvernement de Kiev de créer une République de Dniepropetrovsk.
Dans le même temps, Valentyn Nalyvaichenko, le responsable des services de sécurité ukrainiens, fidèle au Président Poroshenko, a mis en cause deux des gouverneurs adjoints de Dnepropetrovsk, MM. Gennady Korban and Svyatoslav Oliynyk, les accusant « d’appartenir à une organisation à vocation criminelle ». Ces deux personnes contestent bien entendu ces accusations, menaçant d’attaquer pour diffamation M. Valentyn Nalyvaichenko.
Sur le fond, l’essentiel semble être tant la réduction du pouvoir économique de M. Kolomoisky, que l’intégration des bataillons de la Garde Nationale dans l’armée régulière ukrainienne. Or, les commandants de ces bataillons, s’ils déclarent ne pas être opposés à une telle intégration, déclarent qu’il s’agit pour eux d’une intégration en l’état et non d’intégrations individuelles. Ceci est évidemment refusé par le gouvernement de Kiev. A l’heure actuelle, il est clair que, des deux côtés, on cherche à éviter l’irréparable, mais qu’aucun accord de fond n’a été trouvé. Le risque de voir la baronnie de Kolomoisky faire sécession et s’allier à ceux-là même qu’elle combattait férocement hier ne peut donc pas être exclu.
Un indicateur en ce sens est l’appel que Kolomoisky vient de faire diffuser en Ukraine, où il se positionne en adversaire direct du Président, en défenseur de « l’esprit de Maïdan » (qui aura beaucoup servi…) et en défenseur de « l’esprit de dignité » face à un gouvernement d’incapables et de corrompus. Il s’inquiète aussi de la vague de morts suspects qui touche des anciens responsables du parti de Yanoukovitch, le « parti des Régions », et que le gouvernement actuel à Kiev lui qualifie de suicides[3].
Traduction de la proclamation d’Igor Kolomoisky
On sait effectivement ce que valent ce genre d’explication, depuis le suicide de Stavisky en 1934 en France…[4] Derrière les formules et les postures, il y a une réalité : une lutte féroce pour le pouvoir. Kolomoisky appelle ainsi à des manifestations dans tous le pays le samedi 28.
Les évolutions possibles
Cette crise est donc appelée à durer. Elle vient alors que les accords de Minsk sont en partie respectés (le cessez-le-feu, les échanges de prisonniers) mais restent sur le fond lettre morte car le gouvernement de Kiev se refuse toujours à négocier avec les insurgés et ne semble pas prêt à promouvoir une véritable loi de fédéralisation. Elle témoigne aussi de ce que l’Ukraine est dans une situation de très grave crise politique et institutionnelle. L’existence de baronnies autonomes, et susceptibles de devenir indépendantes, ne se limite pas au Sud-Est du pays.
En réalité, les dynamiques potentielles qui sont aujourd’hui à l’œuvre en Ukraine peuvent soit conduire à une reprise des affrontements, par exemple si chacun des camps en présence se décide à jouer de la surenchère nationaliste, soit au contraire ouvrir la voie à la paix si cette crise conduit à prendre au sérieux la question de la fédéralisation du pays. Pour cela, il convient que cette crise débouche effectivement sur un traitement sérieux et ouvert de la question de la fédéralisation.
Le meilleur moyen de mettre fin à la « guerre des oligarques » serait, en effet, d’aborder en pleine transparence et sans tergiverser la question institutionnelle et constitutionnelle en Ukraine. Cette démarche aurait dû être entreprise dès la fuite de M. Yanoukovitch. Cette fuite signifiait que l’ancien « pacte national » qui fondait l’État ukrainien n’était plus valide, ou alors il fallait reconnaître à M. Yanoukovitch le fait qu’il était le Président élu. On ne peut tout à la fois dire qu’il y a eu « révolution », ce qui implique suspension de l’ordre constitutionnel et prétendre en même temps que cet ordre constitutionnel continue d’exister.
Cela n’implique nullement qu’il ne puisse y avoir de « pacte national » et que l’Ukraine ne puisse survivre, mais cela nécessite qu’il soit reformulé. Il est clair qu’un degré de fédéralisation, ou de confédération, s’imposera pour des raisons culturelles, religieuses et linguistiques. Le refus de reconnaître cette situation a conduit d’une part à la décision des habitants de la Crimée à se rattacher à la Russie et d’autre part à l’insurrection dans l’Est de l’Ukraine. Il faut ici souligner que la Russie s’est jusqu’à présent toujours refusée de reconnaître les républiques de Donetsk et de Lougansk. Il convient de reprendre aujourd’hui ce dossier. Il y a urgence. Faute de le faire, et de le faire vite et honnêtement, seule la guerre, et à terme le démantèlement de l’Ukraine, resteraient des options.
_______________
[1] http://www.rts.ch/info/monde/6651675-un-milliardaire-ukrainien-fait-trembler-kiev-et-berne.html
[2] B. Jarabik, « Ukraine, the kingdom of the oligarchs », Carnegie foundation, http://carnegie.ru/eurasiaoutlook/?fa=59487
[3] Parmi les personnes « suicidées » :
- Le 26 Janvier 2015 se suicide Nikolai Sergienko, 57 ans, l’ex chef adjoint des “Chemins de fer ukrainiens”, il s’ est tiré une balle avec un fusil de chasse.
- Le 29 Janvier à son domicile on trouve le corps de Alex Kolesnik, ancien président de l’administration régionale de Kharkov.
- Le 25 février est retrouvé pendu le maire de Melitopol, Sergei Walter, 57 ans.
- Le 26 février est retrouvé dans son garage le cops de l’adjoint-chef de la police de Melitopol, Alexander Bordyuga, 47 ans.
- Le 28 février, l’ancien vice-président du Parti des régions Mikhaïl Chechetov « saute » par la fenêtre de son appartement.
- Le 10 mars 10 se suicide l’ ex-député des Parti des Régions” Stanislav Miller.
- Le 12 mars se suicide l’ ancien président de l’administration régionale de Zaporozhye, Oleksandr Peklushenko.
[4] Stavisky, qui avait corrompu (et avait été protégé par) une partie de la classe politique de l’époque était censé s’être suicidé en se tirant une balle dans la tête depuis une distance de 2m. Le Canard Enchainé avait pu titrer « ce que c’est que d’avoir le bras long… ».