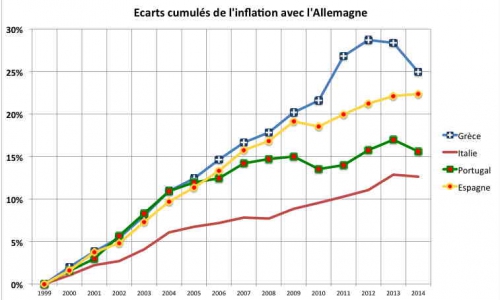Grèce : l'ultimatum des créanciers fait « pschitt »
Alexis Tsipras a rejeté l'offre des créanciers, mais les discussions se poursuivent. L'ultimatum est donc déjà caduc. Mais le nœud gordien des négociations demeure : les retraites.
La réunion entre le premier ministre grec Alexis Tsipras et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a donc échoué mercredi 3 juin (2015) au soir. Jeroen Dijsselbloem, le président de l'Eurogroupe, convoqué pour retranscrire les termes d'un éventuel accord et convoquer dans la foulée une réunion des ministres des Finances de la zone euro, est donc reparti sans rien avoir à faire. Le blocage persiste, mais les discussions, affirme-t-on, vont continuer.
L'échec de cette énième « rencontre de la dernière chance » et le fait même que les discussions continuent prouvent en tout cas que la manœuvre des créanciers consistant à proposer une « dernière offre » à Athènes qui serait « à prendre ou à laisser » a d'ores et déjà échoué. Cette forme dérivée d'ultimatum puisque la date limite n'était pas fixée officiellement, mais basée sur les échéances de remboursement de la Grèce n'a pas davantage été suivie d'effet que le précédent ultimatum de fin mars lorsque les créanciers avaient enjoints Athènes de présenter une « dernière » liste de réformes... avant d'en demander d'autres.
Un plan en forme de provocation
Ce plan soumis par les créanciers mercredi 3 juin au gouvernement grec était, il est vrai, inacceptable pour Alexis Tsipras et son gouvernement. Même le quotidien conservateur Ta Nea titre ce jeudi matin sur une « taxe de sang pour un accord. » Ce plan, fruit de pénibles discussions entre les représentants de la zone euro et du FMI, était une véritable provocation. Certes, il assouplit les objectifs d'excédents primaires (hors service de la dette) par rapport au plan de 2012 : 1 % du PIB en 2015 au lieu de 3 %, 2 % en 2016 au lieu de 4,5 %. Mais compte tenu de la dégradation de la conjoncture, ces objectifs signifiaient encore des coupes budgétaires massives.
Les créanciers réclament aussi une modification du régime de la TVA, avec deux taux au lieu de trois. Un taux principal qui demeure à 23 % et un taux « unifié » à 11 % qui regroupe les deux taux réduits actuels de 13 % et 6,5 %. Ceci signifie que les produits de base et l'énergie verraient leur taux de TVA passer de 6,5 % à 11 %. Enfin, les créanciers réclament une suppression des exemptions pour les îles de l'Egée. En tout, la TVA sera alourdie de 1,8 milliard d'euros. Enfin, les créanciers exigent des coupes dans les retraites dès juillet, de 0,25 % à 0,5 % du PIB pour 2015 et 1 % du PIB en 2016. Et le report de la retraite complémentaire pour les pensionnés les plus faibles jusqu'en 2016.
C'était imposer une nouvelle cure d'austérité à l'économie grecque et affaiblir encore les plus fragiles. Et c'était donc aussi chercher à provoquer l'aile gauche de Syriza et à obtenir sa dissidence par la volonté nette « d'enfoncer » les « lignes rouges » sur les retraites du gouvernement Tsipras. Le premier ministre le sait, il a donc rejeté immédiatement ce plan. Ce jeudi 4 juin au matin, le gouvernement grec a donc rejeté officiellement le plan des créanciers : « ce n'est pas une base sérieuse de discussion. » Dès mercredi soir, avant son départ pour Bruxelles, Alexis Tsipras avait assuré que « à la fin de la journée, la seule option réaliste restera le plan grec. » Ce dernier, soumis le lundi 1er juin aux créanciers, prévoit des excédents primaires de 0,8 % du PIB cette année et 1 % l'an prochain, une réforme « neutre » de la TVA et la suppression des schémas de départ en préretraites.
Bluff de l'ultimatum
Le premier ministre hellénique a donc fait preuve de sang-froid et a, de facto, rejeté « l'ultimatum. » Si cet ultimatum en était réellement un, il n'y aurait plus de discussions possibles. Or, ce n'est pas le cas. Alexis Tsipras a même fait preuve de bonne volonté en annonçant que la Grèce paiera son échéance de 300 millions d'euros environ au FMI vendredi 5 juin, ce qui permet de poursuivre les discussions. C'est clairement une volonté de ne pas « rompre » avec les créanciers, mais c'est aussi la preuve qu'on peut discuter la proposition des créanciers, ce qui est l'inverse de la définition d'un ultimatum. Mercredi, le porte-parole du groupe parlementaire de Syriza, Nikos Fillis, avait prévenu qu'il n'y aurait pas de paiement « sans perspective d'un accord. » Il faut donc considérer qu'il y a une telle perspective. Selon Dow Jones, le premier ministre grec pourrait faire une contre-proposition. Tout ceci signifie donc que cet ultimatum n'en était pas un. C'était un bluff destiné à forcer la décision des Grecs.
Premières concessions des créanciers
En réalité, les créanciers semblent de plus en plus désemparés par la fermeté grecque. Ils lancent des ultimatums, mais ne peuvent accepter de tirer les leçons d'un rejet de ces derniers, autrement dit provoquer le défaut grec. Peu à peu, leur position de faiblesse devient plus évidente. Et ils commencent à reculer. Selon le Wall Street Journal, les créanciers abandonneraient désormais leurs exigences de réductions d'effectif dans la fonction publique et de réformes du marché du travail. Ce dernier point était une des « lignes rouges » du gouvernement grec qui obtient ici une nette victoire. De plus, selon France 24, François Hollande et Angela Merkel auraient accepté, mercredi soir, dans une discussion téléphonique avec Alexis Tsipras, qu'il fallait abaisser les objectifs d'excédents primaires. Ce pourrait être une ouverture pour accepter les objectifs helléniques.
Des concessions contre des coupes dans les pensions ?
Qu'on ne s'y trompe pas cependant : ces concessions pourraient n'être qu'un moyen d'arracher l'acceptation par Athènes de ce qui apparaît comme le nœud gordien de ces discussions : la réforme des retraites et les coupes dans les pensions. Il devient progressivement de plus en plus évident que le camp qui cèdera sur ce point aura perdu la partie en termes de communication. L'obsession des créanciers pour la réduction des pensions en a fait un sujet clé. Or, socialement et politiquement, le gouvernement Tsipras ne peut accepter ces mesures. « La question des retraites est un sujet des plus symbolique non seulement pour les citoyens grecs, mais aussi pour un gouvernement qui se dit de gauche », affirme une source proche du gouvernement à Athènes qui ajoute : « pour le gouvernement, une nouvelle réduction des retraites est absolument exclue. » Le gouvernement grec ne semble donc pas prêt à « négocier » les retraites contre l'abandon des exigences concernant le marché du travail. Car si le système de retraite grec est difficilement tenable à long terme (mais les systèmes allemands et français le sont tout autant), si même dans le gouvernement grec, on convient à demi-mot qu'il faudra sans doute le réformer un jour, il est impossible d'y toucher aujourd'hui. Pour deux raisons.
Pourquoi Alexis Tsipras ne peut céder sur les retraites
La première est sociale. Tant que le chômage est élevé et que le taux d'indemnisation des chômeurs est faible (14 %), les retraites ont une fonction sociale centrale. Elles permettent de faire jouer la solidarité familiale. C'est un amortisseur incontournable. Baisser à nouveau les retraites ne frappera donc pas que les retraités, cela frappera toute la société et notamment les jeunes dont le taux de chômage, rappelons-le, est de 60 %. La réforme des retraites ne peut donc intervenir dans cette situation. Il faut d'abord recréer les conditions de la croissance et de la reprise de l'emploi. La seconde raison est politique. Baisser les pensions dès la première année pour un gouvernement de gauche, c'est faire ce qu'Antonis Samaras avait refusé. C'est donc abandonner symboliquement son positionnement de gauche. Nouvelle Démocratie et le Pasok auront beau jeu de prétendre qu'ils défendaient mieux les retraités et les chômeurs que Syriza. Ce serait aussi inévitablement conduire Syriza à la rupture, beaucoup au sein du parti estimant, non sans raison, qu'il s'agit là d'une trahison et que, dans les futures élections, il faudra s'être présenté comme un défenseur des retraités. Alexis Tsipras ne peut accepter ces deux conséquences. Il est donc peu vraisemblable qu'il cède sur ce point.
Blocage
Bref, comme le signale la source athénienne déjà citée : « le gouvernement acceptera tout accord qui sera ressenti comme un progrès par rapport à la situation d'avant le 25 janvier. » Autrement dit, le gouvernement grec ne peut accepter d'accord avec des baisses dans les pensions. Mais, on l'a vu, les créanciers, n'ont désormais pour but principal que cette question des retraites. Le blocage semble donc total et les créanciers, eux, pourraient être tentés par un « report à plus tard » des discussions, mais pour cela, il faut trouver un moyen de financer les quelques 12 milliards d'euros que la Grèce doit payer d'ici à septembre prochain. Or, verser les fonds à Athènes sans accord serait aussi une défaite symbolique pour les créanciers...
Biais idéologique
En réalité, ce blocage n'est dû qu'à ce biais idéologique que portent les créanciers et qui centre la solution sur une vision comptable de l'économie. La solution au problème des retraites, comme aux autres maux de la Grèce, est pourtant ailleurs : il est dans la relance de l'économie grecque, dans sa reconstruction, dans la restructuration de sa dette publique et privée et dans la lutte active contre le chômage. Dès lors, une réforme des retraites deviendra possible. Mais la situation semble avoir échappé à toute logique. Et c'est bien pourquoi Alexis Tsipras estime que seul le plan grec est une base « réaliste » à la discussion
Romaric Godin